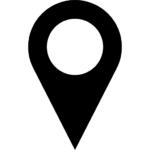Basilique de Saint-Laurent
Europe,
Italie,
citta, Florence,
San Lorenzo
La Basilique de San Lorenzo à Florence est un lieu d’une importance historique et artistique extraordinaire, non seulement pour son architecture mais aussi pour son lien profond avec la famille Médicis. Située au cœur du quartier de San Lorenzo, cette église a été l’une des principales églises paroissiales de la ville et a servi de centre de pouvoir spirituel et politique pendant des siècles.
La basilique que nous voyons aujourd’hui est le résultat d’un projet ambitieux commencé en 1419 par Filippo Brunelleschi, l’un des architectes les plus influents de la Renaissance. Commandée par Giovanni di Bicci de’ Medici, le fondateur de la dynastie Médicis, l’église devait remplacer une structure romane du XIe siècle précédente, elle-même construite sur un site de culte du IVe siècle. Brunelleschi a introduit un langage architectural innovant basé sur des principes de proportion, de symétrie et d’harmonie, en utilisant des formes géométriques simples comme des cercles et des carrés pour créer un espace exprimant une beauté calme et rationnelle.L’un des éléments les plus fascinants de la basilique est la Vieille Sacristie, achevée en 1440 et considérée comme l’un des premiers chefs-d’œuvre de la Renaissance. Cet espace servait à la fois de sacristie et de mausolée pour Giovanni di Bicci et sa femme Piccarda Bueri. La Vieille Sacristie se caractérise par l’utilisation de la pierre serena, une pierre grise locale, et par un design basé sur des proportions géométriques rigides, qui confèrent à l’environnement un sentiment d’équilibre et d’ordre.À la mort de Brunelleschi en 1446, les travaux ont été achevés par Antonio Manetti, qui a largement respecté les plans originaux du maître. Cependant, la façade de la basilique, conçue par Michel-Ange en 1518, est restée inachevée en raison de problèmes financiers et logistiques, laissant l’extérieur du bâtiment avec un aspect brut qui contraste avec la sophistication des intérieurs.L’intérieur de la basilique est un triomphe de lignes épurées et d’espaces lumineux. Les colonnes en pierre serena soutiennent des arcs en plein cintre, créant une séquence rythmique de pleins et de vides qui guident le regard vers l’autel. Le plafond à caissons et les murs blancs amplifient la lumière naturelle, accentuant la sensation d’espace et de sérénité.La Nouvelle Sacristie, ou Chapelle des Princes, a été ajoutée entre 1520 et 1534 sur le projet de Michel-Ange, comme mausolée pour certains membres de la famille Médicis. Cet espace combine architecture et sculpture en une œuvre d’art unitaire, avec des tombes monumentales décorées de statues allégoriques du Jour et de la Nuit, de l’Aube et du Crépuscule, représentant le cycle de la vie et de la mort. Michel-Ange a conçu non seulement la structure architecturale mais aussi les sculptures, créant un dialogue entre architecture et art qui est typique de son style.Un autre joyau du complexe est la Bibliothèque Médicéenne Laurentienne, également conçue par Michel-Ange et commencée en 1524. La bibliothèque abrite une vaste collection de manuscrits rassemblés par les Médicis, comprenant des œuvres d’auteurs classiques tels que Pline et Sophocle, ainsi que des humanistes de la Renaissance comme Marsile Ficin et Pic de la Mirandole. L’escalier monumental menant à la salle de lecture est un chef-d’œuvre du maniérisme, avec une structure qui défie les conventions architecturales de l’époque.San Lorenzo est également célèbre pour les œuvres d’art qui ornent ses chapelles et ses nefs. Parmi celles-ci, les chaires en bronze de Donatello se distinguent, achevées par ses assistants en 1460. Ces chaires représentent des scènes de la Passion et de la Résurrection du Christ et sont connues pour leur réalisme dramatique et leur complexité iconographique.La basilique est entourée de deux cloîtres : le Cloître des Chanoines et le Cloître des Cyprès. Le premier, conçu par Antonio Manetti, est un exemple parfait d’architecture de la Renaissance avec une loggia à deux étages et des colonnes ioniques, tandis que le second conserve l’empreinte originale de Brunelleschi.
En savoir plus