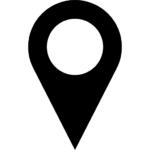Église de Saint-Jean le Majeur
Europe,
Italie,
citta, Naples,
San Giuseppe
L’église de San Giovanni Maggiore, située dans le centre historique de Naples, est l’un des témoignages les plus anciens et fascinants de l’architecture religieuse de la ville. Fondée probablement au VIe siècle, elle se dresse sur un temple païen préexistant, peut-être dédié à Hercule ou Antinoüs. L’église a subi de nombreux travaux de reconstruction et de restauration au fil des siècles, reflétant les principaux périodes historico-artistiques traversées par Naples, du paléochrétien au baroque, jusqu’au néoclassique.
La légende raconte que Constantin le Grand a ordonné la construction de l’église pour remercier Dieu d’avoir sauvé sa fille Constance d’un naufrage. Bien que cette histoire ne soit pas confirmée historiquement, elle ajoute une aura de mystère et de sacralité à l’endroit. L’église a été remaniée par l’évêque Vincenzo au VIe siècle et insérée parmi les quatre principales basiliques de la ville, aux côtés de San Giorgio Maggiore, Santi Apostoli et Pietrasanta.La structure originale était riche en mosaïques et en coupoles, témoignant de la prospérité et de l’importance de la communauté chrétienne locale pendant la domination byzantine. Par la suite, l’église a subi des transformations significatives pendant la période normande et angevine. C’est à ces périodes que remontent l’élargissement des nefs latérales et la refonte du transept.En 1635, un tremblement de terre a gravement endommagé l’église, et en 1656, Dionisio Lazzari a été chargé de la restaurer. Lazzari a introduit des éléments baroques, comme la double coupole, une solution architecturale unique dans la ville. Cependant, d’autres tremblements de terre en 1732 et en 1805, suivis d’un autre séisme en 1870, ont causé des dommages étendus, détruisant une partie de la nef droite et faisant effondrer la voûte.Pendant les restaurations néoclassiques voulues par le chanoine Giuseppe Perrella en 1872, sur le projet de l’ingénieur Giorgio Tomlison et avec les corrections d’Errico Alvino et Federico Travaglini, l’église a pris son aspect actuel. Le plafond du XIXe siècle, réalisé après le tremblement de terre de 1870, présentait trois grandes représentations picturales, dont le Baptême de Jésus et d’autres scènes de la vie de Saint Jean-Baptiste, exécutées par Nicola Montagono et Domenico Leggieri. Malheureusement, un nouvel effondrement de la voûte en 1970 a détruit ces œuvres, obligeant l’église à fermer pendant quarante-deux ans.Pendant les travaux de restauration des années 1970, d’importantes traces de l’époque paléochrétienne ont été découvertes, comme l’abside semi-circulaire sous le chœur en bois du XVIIe siècle, désormais déplacé dans l’oratoire des LXVI Sacerdoti. La restauration a également mis au jour deux panneaux de l’ancien calendrier de l’église napolitaine, gravés en 887, désormais conservés à l’archidiocèse de Naples.Parmi les œuvres d’art présentes dans l’église, on peut citer les toiles du XVIIe siècle d’un auteur napolitain inconnu et l’Adoration des Mages de l’atelier d’Andrea Sabatini. Certaines de ces œuvres ont été placées dans des musées de la ville pour les protéger de tout dommage supplémentaire, comme dans le cas des Noces de la Vierge et de Jésus dans l’atelier de Saint Joseph attribuées à Diana De Rosa, désormais au Musée Diocésain de Naples.En janvier 2012, l’église a finalement été rouverte grâce à l’intervention de l’Ordre des Ingénieurs de la Province. Depuis lors, en plus de redevenir un lieu de culte consacré, la basilique accueille fréquemment des événements culturels, devenant un point de référence non seulement religieux, mais aussi social et culturel pour la communauté napolitaine.L’intérieur de l’église, avec sa croix latine et ses trois nefs, est enrichi d’une double coupole conçue par Lazzari, d’un maître-autel de Domenico Antonio Vaccaro et de deux colonnes romaines en marbre cipolin du VIe siècle. La crypte, accessible par un escalier à gauche de l’entrée principale, présente trois nefs voûtées en berceau et un autel du XVIIIe siècle décoré de la Vierge du Rosaire.La nef gauche conserve d’importantes traces artistiques, notamment la Chapelle des Paléologues, avec une fresque du XVIe siècle de la Vierge à l’Enfant et une sculpture en bois du XIVe siècle de Saint Jean bénissant. La Chapelle Ravaschieri abrite un retable en marbre de Giovanni da Nola, tandis que la Chapelle de Sainte Anne est décorée d’une sculpture en bois de Gennaro Vassallo.
En savoir plus