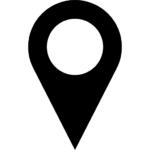Aqueduc des Eaux Libres
Europe,
Portugal,
citta,
Campolide
L’aqueduc des Eaux Libres, une œuvre majestueuse et représentative de la capacité d’ingénierie du XVIIIe siècle, se dresse comme un témoin silencieux de l’histoire de Lisbonne. Sa construction, initiée en 1731 par décret du roi Jean V, représente une tentative ambitieuse et réussie de résoudre les problèmes d’approvisionnement en eau de la ville, qui souffrait alors d’une pénurie chronique d’eau potable. Financé par une taxe sur les biens de consommation tels que la viande, le vin et l’huile d’olive, l’aqueduc a été conçu pour exploiter les sources naturelles situées au nord-ouest de Lisbonne.
L’idée de construire un aqueduc pour amener de l’eau à Lisbonne a été initialement proposée par le Procurador da Cidade, qui en 1728 a proposé un impôt spécial pour collecter les fonds nécessaires. Le projet a vu la collaboration de personnalités de l’époque, dont l’Italien Antonio Canevari, l’Allemand Johann Friedrich Ludwig et le Portugais Manuel da Maia. Bien que Canevari ait lancé le projet, c’est Manuel da Maia qui a mené l’œuvre à bien, définissant son parcours et ses caractéristiques techniques.
L’aqueduc s’étend sur environ 58 kilomètres, du point de captage des eaux à Belas jusqu’aux différents points de distribution dans la ville. Son tronçon le plus emblématique est sans aucun doute celui qui traverse la vallée d’Alcântara, où une séquence de 35 arches monumentales s’élève majestueusement jusqu’à 65 mètres de hauteur. Ce segment, connu sous le nom d’Arco Grande, est un symbole de résistance et de beauté, ayant même résisté au dévastateur tremblement de terre de 1755 qui a détruit une grande partie de Lisbonne.
La réalisation de l’aqueduc n’a pas été exempte de difficultés et de controverses. En 1744, après la mort de Custódio Vieira, la direction des travaux est passée à Carlos Mardel, un architecte hongrois qui a dû prendre des décisions cruciales pour l’achèvement de l’œuvre. Parmi celles-ci, le choix de l’emplacement du réservoir principal, la Mãe d’Água. Initialement prévue près de São Pedro de Alcântara, sa construction a été déplacée à Amoreiras, une décision qui a suscité des débats mais s’est révélée stratégique pour la distribution de l’eau dans la ville.
Le réservoir de Mãe d’Água, achevé en 1834, est en soi un chef-d’œuvre d’ingénierie. Avec une capacité de 5 500 mètres cubes, il servait de principal point de collecte et de distribution pour tout le réseau urbain. Aujourd’hui, cet espace a été transformé en musée, où les visiteurs peuvent explorer l’histoire du système hydrique de Lisbonne et admirer la vue panoramique depuis son toit.
L’aqueduc est resté opérationnel jusqu’aux années 1960, lorsqu’il a été progressivement remplacé par des infrastructures plus modernes. Cependant, sa présence continue de marquer le paysage urbain de Lisbonne, non seulement comme un monument historique, mais aussi comme le symbole d’une ville qui a su relever et surmonter les défis de son époque.
Du point de vue architectural, l’Aqueduc des Eaux Libres est un magnifique exemple de baroque et de néoclassicisme, un mariage de styles qui reflète l’époque de sa construction. Ses arches élégantes et puissantes, réalisées avec une précision géométrique, confèrent à toute la structure une majesté intemporelle. Chaque arche est un témoignage du savoir-faire des ingénieurs et des artisans de l’époque, capables de réaliser une œuvre non seulement fonctionnelle, mais aussi esthétiquement impressionnante. Parmi les anecdotes historiques, il convient de mentionner que l’aqueduc a été le théâtre d’épisodes curieux et tragiques. Au XIXe siècle, il a été utilisé par des criminels comme cachette et voie de fuite, sa longueur permettant de traverser la ville sans être vu. Le plus célèbre d’entre eux était Diogo Alves, un bandit qui exploitait la structure pour voler et parfois tuer les passants, jetant ensuite leurs corps depuis le sommet des arches.
En savoir plus